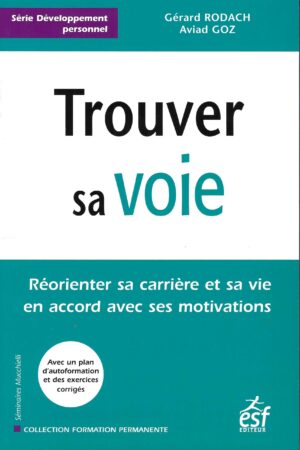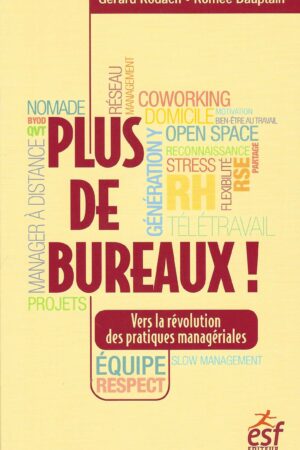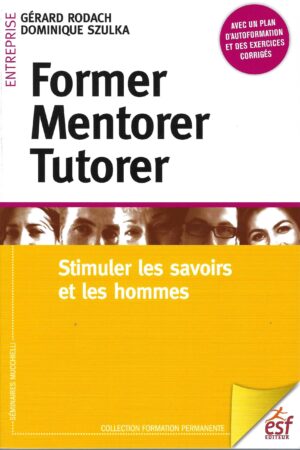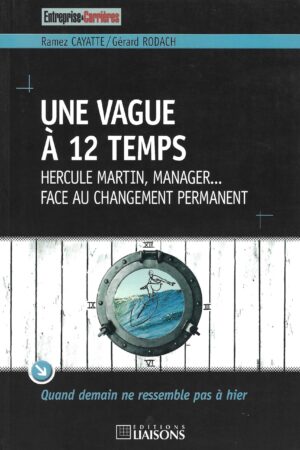Au printemps 2013, l’anthropologue américain David Graeber, fait sensation avec un article sur les «boulots à la con». Qu’est-ce que ce type de boulot pour lui ? « Une forme de travail rémunéré qui est si inutile, dispensable ou nuisible que même l’employée ou l’employé ne peut justifier son existence, même si […] elle ou il se sent obligé de prétendre que ce n’est pas le cas.»
Au printemps 2013, l’anthropologue américain David Graeber, fait sensation avec un article sur les «boulots à la con». Qu’est-ce que ce type de boulot pour lui ? « Une forme de travail rémunéré qui est si inutile, dispensable ou nuisible que même l’employée ou l’employé ne peut justifier son existence, même si […] elle ou il se sent obligé de prétendre que ce n’est pas le cas.»
Sa réflexion partait à l’origine d’une interrogation : comment expliquer l’existence d’emplois qui apparaissent inutiles d’un point de vue extérieur et que leur occupantes et occupants jugent d’ailleurs comme tels ?
L’anthropologue américain distingue cinq catégories.
Les «flunky jobs» (les «boulots de larbin») pour flatter l’ego d’un supérieur.
Les «goons» (les «boulots débiles») par mimétisme (lobbyistes…) .
Les «duct tapers» (les «boulots chatterton») dus à des défauts structurels d’une organisation, qu’ils doivent colmater en permanence.
Les «box tickers» (les «boulots cases à cocher») permettent à une organisation de dire qu’elle fait quelque chose qu’elle ne fait en réalité pas.
Graeber divise son dernier type de boulots à la con, les «taskmasters» (les «boulots de tyran»), en deux sous-catégories: les boss qui distribuent du travail qui pourrait très bien être réalisé sans leur intervention, et celles et ceux qui encadrent la réalisation de boulots à la con et –surtout– en inventent de nouvelles formes.
Graeber considère que la condition moderne salariale a entraîné un sentiment de dépossession (perte de la maîtrise de son temps et de la finalité de ses actions), exacerbé quand la pertinence même du travail est remise en cause. Si de telles activités sont évidemment sources d’ennui, elles produisent aussi du stress, de l’anxiété et surtout des tensions.
D’autres personnes ressentent un malaise par rapport aux revenus qu’elles perçoivent au regard de l’utilité de leurs tâches. En même temps, ces employées et employés se sentent piégés par la nécessité de nourrir leur famille ou de payer leurs factures.
De tels constats amènent Graeber à parler d’un «féodalisme managérial» à l’heure de la financiarisation de l’économie. Les gains de productivité ne sont plus répartis entre capital et travail comme durant les Trente Glorieuses, mais appropriés par la finance, qui les redistribue au sein d’un tout petit groupe à l’aide d’organisations hiérarchiques fonctionnant comme au Moyen Âge.
Notre absence de réaction trouverait son explication dans notre conception théologique du travail, consacré comme un devoir, vécu à la fois comme une bénédiction et une malédiction. Un consensus existe autour du fait que ne pas travailler est une attitude répréhensible.
À ces considérations s’en ajoutent également de plus matérielles: l’avènement de la société de consommation nous pousse à travailler pour satisfaire nos multiples besoins, qui nous permettront en retour de nous reposer brièvement de nos efforts.
Nous vivons la fin du travail comme une catastrophe au lieu de nous en réjouir.Keynes avait raison lorsqu’il prédisait l’automatisation de nombreuses tâches et la réduction de moitié du temps de travail, nous ne nous en sommes juste pas encore aperçus. En attendant, toujours selon Graeber, nous avons comblé une partie du vide avec des boulots à la con et nous vivons la fin du travail comme une catastrophe au lieu de nous en réjouir, puisque nous n’y sommes préparés ni politiquement, ni culturellement.